-
Après la page scolastique, qui s'étend sur près de quatre siècles, non sans heurts et scissions, l'Eglise va progressivement perdre de sa superbe. Les crises du XIV et du XV (famines, guerres, maladies, récession économique), vont affaiblir une grande partie de l'Europe. Mais parallèlement, les caisses des Princes grossissent. Après la modération consacrée par l'Eglise dans les affaires d'argent, les conquêtes et la route de l'Orient (ouverte par les Croisades) vont profiter à l'enrichissement des royaumes. Les Princes deviennent puissants, ils se renforcent et s'émancipent du diktat de l'Eglise catholique. Progressivement, entre le XV et le XVIII, le pouvoir du Prince va se substituer au pouvoir de l'Eglise et au système féodal. C'est aussi la période qui va voir émerger l'idée de Nation.

Sur le plan intellectuel, l'émancipation de la foi se fait difficilement. L'Eglise continue d'imposer la pensée des anciens grecs, tandis que de nouvelles découvertes mettent à mal les textes des anciens, et en cela la parole de l'Eglise. Mais comme souvent dans l'Histoire, l'autoritarisme est aussi une marque de faiblesse qui tente de sauver ce qui est déjà en perdition. L'Inquisition, le bûcher, la « chasse aux sorcières » masquent en réalité la lente déréliction de la domination de l'Eglise.
Tous les géants sur laquelle la pensée médiévale (scolastique) et le dogme catholique reposaient chutent de leur piédestal. C'est une véritable révolution presque ontologique qui se produit au XV en Europe, en tout cas un véritable bouleversement de la représentation du monde et de la place des hommes dans ce monde avec le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme entre autres. Bien évidemment, l'Eglise refusera toutes ces nouvelles idées, avec force et autorité, usant des méthodes précédemment exposées.
Mais les observations de la nature et les analyses empiriques se développent (Kepler, Neper, Brahé, Galilée, de Vinci, etc.) contribuant à renouveler la connaissance du monde. Ainsi, les principes aristotéliciens vont être remis en cause (Rabelais, Montaigne) ; la médecine de Galien se verra discréditée avec l'observation méticuleuse des corps. Notamment, le savant W. harvey (1578-1657) qui met à jour le principe de la germination du vivant et celui de la circulation sanguine, faisant du coeur une pompe à sang et pas uniquement le lieu de l'âme comme Galien l'affirmait. Cette découverte du principe dynamique de la circulation sanguine connaîtra un riche succès quelques années plus tard en économie avec le Tableau économique de Quesnay (mais nous verrons cela plus loin). De la même manière l'Almageste de Ptolémée est remis en cause par l'observation précise du Ciel par N. Copernic (1473-1543).
Le monde devient accessible à la connaissance rationnelle et une conception horlogère du monde se met en place petit à petit avec les travaux des astronomes.
Quant à l'économie de son côté, forte de ces avancées de la Raison et de la sécularisation du savoir, elle va progressivement se constituer comme une discipline autonome, laïcisée, débarrassée de toute prescription théologique. Ce sera les grands débuts de ce qu'on nommera par la suite le mercantilisme, même si l'ensemble des principes économiques à cette époque ne peuvent pas être véritablement encore rassemblés autour d'une Ecole de pensée.
La pensée des mercantilistes repose sur quelques grands principes. La richesse d'un royaume dépend de la puissance de son Prince, lui-même tributaire de sa capacité à lever, armer et rétribuer ses armées. La richesse se mesure alors par l'accumulation de matières précieuses. Moyen de la puissance du Royaume, l'or et les métaux précieux sont alors recherchés.
Concrètement, le mercantilisme repose donc sur une analyse où se rejoignent plusieurs idées :
-
le chrysohédonisme (ou le bonheur dans l'accumulation de l'or) qui place la recherche et l'accumulation de la monnaie comme source de puissance de l'Etat, et donc constitue à ce titre la richesse de ce dernier ;
-
le nationalisme, reposant sur l'idée exprimée par Montaigne que « nul ne gagne qu'un autre ne perde » (ou ce qu'on appelle aujourd'hui de manière moins poétique un jeu à somme nulle). Ce qu'une Nation gagne, elle le fait au détriment de ses voisines. En l'occurrence, cette idée était tout à fait valable lorsque la richesse était calculée à partir d'une quantité finie de stock d'or. La possession d'une Nation en privait mécaniquement l'autre.
Pour parvenir à augmenter son stock d'or, il convient alors de développer son industrie locale afin d'exporter ses marchandises (entrée de devises) et réduire au maximum les importations (sortie de devises). On dirait aujourd'hui entretenir un solde positif de la balance commercial (ce qui est loin d'être le cas pour la France aujourd'hui!)
-
ainsi, la pensée mercantiliste est une forme de pensée protectionniste avant l'heure (et qui sera fortement critiquée par les classiques, favorables au contraire au libre-échange, considérant alors que « tous ont à y gagner », que c'est un jeu à somme positive)
-
en outre, le mercantilisme est aussi étatique ; il prône la mise en place de subventions aux exportations, le développement de grandes manufactures d'Etat (le colbertisme en France), une politique populationniste, accroissant la quantité de main d'œuvre disponible. À l'inverse, l'Etat devra taxer les importations, sauf en matières premières, nécessaires à l'industrie et l'artisanat.
Néanmoins, derrière ces grandes lignes de pensée, le mercantilisme ne constitue pas une école en soi et nous verrons dans notre prochain billet les différentes approches mercantilistes que l'Europe a connu, entre l'Espagne, la France et l'Angleterre.
 1 commentaire
1 commentaire
-
-
A partir du XI siècle, l'Europe connaît une croissance importante. L'amélioration des techniques agricoles (assolement triennal et défrichement) permet d'accroître la production alimentaire. Dans le même temps, les relations avec l'Orient se développe (parallèlement aux Croisades qui ont ouvert des voies commerciales) et le commerce du textile de de la production artisanale s'accroît. Cette croissance est à la fois cause et conséquence du développement démographique rapide de l'Europe à cette époque. Entre le XI et la fin du XIII siècle, la population européenne passe ainsi de 40 à 70 millions. Des villes émergent qui concentrent les activités économiques, bancaires et commerciales. Elles vont devenir de vrais carrefours d'échange économique (et social) provenant du monde entier : Gand, Bruges, Gènes, Florence.
Cette période de croissance (initiée également par la relative paix qui régnera sur l'Europe durant près de trois siècles avec la domination incontestée de l'Eglise) est considérée par l'historien Georges Duby comme une révolution agricole médiévale1, associée à « une poussée urbaine incontestable » selon P. Bairoch2 A ce titre, il propose de parler de révolution économique médiévale pour la période s'étalant de 1000 à 1350 environ3. Mais cette période faste prendra fin au XIV, avec le retour des guerres, de la famine (raisons climatiques) et de la maladie (la peste noire décimera environ 40% de la population européenne entre 1357 et 1362!).
 Si le nouveau millénaire s'ouvre par un retour de la croissance en Europe, il marque aussi le retour progressif de la pensée grecque au coeur de l'histoire médiévale. Les intellectuels vont se réapproprier les textes d'Aristote essentiellement (mais aussi de Galien et d'Hippocrate pour l'étude de la médecine) et tenter de les faire concilier avec le dogme catholique.
Si le nouveau millénaire s'ouvre par un retour de la croissance en Europe, il marque aussi le retour progressif de la pensée grecque au coeur de l'histoire médiévale. Les intellectuels vont se réapproprier les textes d'Aristote essentiellement (mais aussi de Galien et d'Hippocrate pour l'étude de la médecine) et tenter de les faire concilier avec le dogme catholique.C'est la scolastique, à savoir le temps consacré à l'étude, et plus précisément en ce début de XI à l'étude du dogme catholique auréolé de la diffusion par les Arabes des écrits d'Aristote.
Si on devait rapidement définir la scolastique, on pourrait la considérer comme une école de pensée visant à concilier la théologie avec la philosophie d'Aristote., avec pour but d'unifier le principe de la foi à celui de la raison.
Le représentant sans doute le plus illustre de cette école est Thomas d'Aquin (1225-1274) qui réussira l'exercice incroyable de concilier les écrits d'Aristote au dogme chrétien. C'est vraiment à partir du XIII siècle que l'Eglise adoptera définitivement les principes aristotéliciens d'explication du monde et le principe ptoléméen du Cosmos. Désormais, ils feront autorité et ne pourront plus être remis en cause.
Comment Thomas d'Aquin arrive t-il à concilier foi et raison, dogme catholique et pensée grecque?
Il constate effectivement qu'a priori, la pensée d'Aristote a raison d'être contestée. Mais à l'examen attentif de l'oeuvre, il faut considérer a posteriori qu' Aristote, sans le reconnaître, pose nécessairement le principe du Dieu unique. Comment?
-
le mouvement, principe aristotélicien essentiel, exige un moteur initial nous dit Thomas d'Aquin ;
-
le logique causale qui prévaut dans l'explication des phénomènes nécessite inévitablement une causalité première (causa prima).
-
De même, les différences de degrés dans la perfection des choses et des oeuvres humaines ne peuvent s'apprécier qu'à la mesure d'un étalon absolument parfait ;
-
la finalité (principe finaliste d'Aristote) qui guide les choses dans l'ordre de l'immanence, appelle cependant à une fin des fins conforme au dogme chrétien ;
-
enfin, le couple substance/forme cher à Aristote permet d'expliquer la dualité de la nature humaine entre corps et âme (esprit).
Ainsi, avec la redécouverte d'Aristote et des auteurs grecs, leur diffusion et leur conformité au dogme catholique, l'Eglise va se ranger derrière ces illustres auteurs. Il ne sera plus nécessaire d'aller éprouver ces idées au contact du monde, ni passer par l'observation des choses : il suffira de s'en remettre à l'analyse qu'en avait fait Aristote pour expliquer les phénomènes.
Si la scolastique s'appuie essentiellement sur la philosophie aristotélicienne pour justifier le dogme, elle reprendra également ses idées concernant les problèmes économiques.
Encore une fois, l'économie n'est pas un domaine autonome, une activité particulière de la connaissance, mais elle reste subordonnée aux principes du message chrétien. Ainsi, les doctrines économiques que nous allons présenter ne valent que parce qu'elles sont conformes au dogme. Il n'y a pas encore de véritable pensée ni encore moins d'analyse proprement économique, juste des règles de conduites et des attitudes qui paraissent répondre au droit naturel de lien divin.
- La propriété privée par exemple est considéré comme un droit légitime, naturel, mais non absolu. Il est conforme au droit divin, mais celui-ci ne l'impose pas. Cependant, Dieu a créé le monde pour que l'humanité en jouisse ; il est donc normal que chacun ait sa part à la table de Dieu. En outre, la propriété est bonne car il est observé qu'elle stimule les individus au travail.
- Concernant l'échange, l'idée qui prévaut est celle de la justice commutative initiée par Aristote. Les marchandises doivent s'échanger à leur juste prix. Mais cette notion de juste prix n'est pas clairement définie par les scolastiques. On en reste à une vision descriptive, pragmatique. Il peut s'apprécier et se fixer par l' « estimation commune » (communis aestimatio), donc de manière subjective, mais qui est alors attestée par des hommes non impliqués dans l'échange, et non intéressés (des hommes sages). Il peut aussi être un prix coutumier. Enfin, il est aussi considéré comme égal à son coût de production (valeur-travail). En fait, la marchandise ne peut être vendue à un prix qui spolie le consommateur et/ou qui enrichit le commerçant.
« Le "juste prix" est ainsi délimité à l'intérieur d'une fourchette variable selon le temps et le lieu. Vendre au dessus de la limite supérieure (pretium summum) est une injustice commise envers l'acheteur (profit illicite), vendre au dessous de la limite inférieure (pretium infimum) est une injustice commise envers le vendeur, qui ne pourra pas entièrement couvrir les frais de production du bien4. »
L'idée d'utilité, de rareté ne sont pas encore prises en considération, ou alors marginalement avec Buridan (1364-1429).
- En outre, tout comme Aristote, le regard porté sur les activités marchandes n'est pas positif, car elles risquent de remettre en cause le bon équilibre de la société,voulue par Dieu. Mais il est encore plus hostile à toute forme de prêt à intérêt, source de déséquilibre et de comportement amoral. L'argent n'est qu'un intermédiaire dans l'échange ; la monnaie facilite les transactions, elle ne doit pas être un instrument d'enrichissement en soi. L'argent n'a pas « à faire de petit » comme disait Aristote. Empruntons à ce sujet un passage de Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique (qui reprend précisément les idées d'Aristote sur l'iniquité du prêt à intérêt).
"Recevoir une usure (usura) pour un prêt d'argent est, en soi, injuste, parce que c'est vendre ce qui n'existe pas et donc, manifestement, constitue une inégalité qui est contraire à la justice. Pour bien saisir cela, il faut savoir qu'il y a des choses dont l'usage implique consommation : le vin se consomme par son usage qui est d'être bu, et le froment par le sien qui est d'être mangé. Dans les choses de cet ordre, on ne doit pas supputer à part l'usage de la chose et la chose elle-même; dès que vous en concédez l'usage, c'est par le fait la chose même que vous concédez; par suite, en ces matières, tout prêt implique transfert de propriété. Par conséquent, celui qui voudrait vendre séparément, d'une part, son vin, d'autre part, l'usage de son vin, celui-là vendrait la même chose deux fois, autrement dit vendrait une chose qui n'existe pas, ce qui serait visiblement pécher par injustice. Par la même raison, c'est commettre une injustice, quand on prête du vin ou du froment, que d'exiger double redevance, à savoir la restitution d'une même quantité de la même matière, et d'autre part le prix de l'usage (pretium usus) ou comme on dit une usure (usura) [...].
Mais il y a des choses dont l'usage n'implique pas consommation : ainsi user d'une maison, c'est l'habiter, ce n'est pas la faire disparaître. Aussi peut-on dans ces matières considérer séparément l'une ou l'autre des deux choses, ainsi quand on cède à autrui la propriété d'une maison dont on se réserve pour un temps la jouissance; ou inversement, quand on cède à autrui la jouissance d'une maison dont on se réserve la propriété. C'est pourquoi il est licite de percevoir une redevance pour l'usage d'une maison et, en outre, d'exiger la restitution de la maison prêtée, comme il se produit dans les cas de louage de maison. [...]
Mais l'argent, selon le Philosophe [Aristote] a créé principalement pour servir d'instrument d'échange. Et ainsi le propre et principal usage qu'on peut en faire, c'est de la consommer, c'est-à-dire de le débourser, comme quand on le verse pour des achats. Et par suite, il est, en soi, illicite de percevoir, en retour de l'usage d'une somme prêtée, ce prix qu'on appelle usure (usura)5".Ainsi, les objets de consommation immédiate ne peuvent faire l'objet d'un prêt, à la différence des biens dont on use sans les consommer (c'est-à-dire sans les détruire en fait) comme les maisons, où dans ce cas, il devient possible d'effectuer un prêt à l'usage (mais pas à la consommation donc).
Mais qu'est-ce que l'intérêt? C'est le prix du temps. Or, le temps appartient à Dieu, il n'appartient pas aux hommes. Ils ne peuvent en jouir. L'intérêt est donc contre-nature.
Pour autant, l'activité économique, comme nous le disions en introduction, se développe fortement entre le XI et XIII siècle. Les prêts pour faciliter la production s'accroissent, les activités bancaires progressent. La doctrine va évoluer à ce sujet et certains types de prêts seront autorisés par les théologiens. Pour autant, les choses touchant à l'argent restent toujours mal vues et déconsidérées. L'économie, à l'époque médiévale signifie toujours « la gestion du foyer » et concerne essentiellement la bonne conduite à tenir dans son foyer pour nourrir sa famille, travailler à sa richesse et économiser ses biens. Les activités commerciales et financières appartiennent à la catégorie des arts pécuniers (artes pecuniativae) activités moins nobles que les arts possessifs (artes possessivae) qui ont pour seule finalité la satisfaction des besoins et dans lesquelles se rangent les travaux agricoles et artisanaux.
Le regard de l'Eglise et de l'époque reste encore très méfiant à l'égard de l'argent et des activités commerciales intéressées.
1. G. Duby, « La révolution agricole médiévale » in Revue de géographie de Lyon, vol 29, n°4, 1954, pp.361-366.
2. P. Bairoch, De Jericho à Mexico, Villes et économie dans l'histoire, Paris, 1985.
3. Dans son oeuvre majeure, Victoires et déboires, t I, Histoire économique et sociale du monde du XVI siècle à nos jours, Paris, Folio Gallimard, 2004, p. 39.
5. Thomas d'Aquin, Somme théologique, Question 78, «Du péché d'usure», Paris : Ed. du Cerf, tome 3, 1985.
 1 commentaire
1 commentaire
-
-
Né en 1332 à Tunis, Ibn Khaldoun a tenté dans son œuvre de concilier l'exigence de la rigueur scientifique à la foi religieuse. Ce faisant, il va proposer une explication du devenir historique, s'appuyant sur une analyse scientifique du mouvement des sociétés humaines, à travers les transformations de leur organisation sociale, politique, économique notamment.
Il définit ainsi la cohésion sociale comme la résultante de l'articulation de facteurs psychologiques, sociaux, politiques, économiques et religieux, jusqu'alors considérés séparément.
A partir de l'observance des sociétés humaines, il va procéder à une analyse du devenir historique. Ainsi, il constate que toutes les civilisations sont amenés à disparaître après une plus ou moins longue période d'apogée.
C'est un mouvement de l'histoire indépassable en son sens, mais qui s'appuie sur une analyse minutieuses des considérations sociales, politiques et économiques des sociétés humaines, sans reposer sur une lecture purement divine du devenir.

Ainsi, il écrit : « Les Empires ainsi que les hommes ont leur vie propre [...] ils grandissent, arrivent à l'âge de la maturité, puis ils commencent à décliner [...]. En général, la durée de vie des empires ne dépasse pas trois générations (120 ans environ).1 »
Le développement des civilisations repose ainsi sur une loi des quatre phases : émergence, prospérité et rayonnement, stagnation, décadence et effondrement. Cette loi des sociétés humaines précède de plusieurs siècles les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1721) de Montesquieu, où ce dernier fait aussi le procès de l'organisation sociale, économique et politique de Rome afin de mieux comprendre le rapide déclin de ce Grand Empire d'Occident.
Pour Ibn Khaldoun, si cette loi de l'Histoire est indépassable, il n'en reste cependant pas moins que les hommes peuvent retarder (ou précipiter) l'âge de la décadence, à raison d'un mauvais gouvernement économique de l'empire. Ainsi, le philosophe relève trois propositions d'ordre économique :
-
la prospérité d'un Etat provient de la richesse de ses sujets, en terme de capacité de travail. Dit autrement, la richesse des Nations dépend de la quantité et de la qualité de sa main d'œuvre. (Adam Smith ne dira pas autre chose en 1776).
-
La quantité de richesse engendrée par la production est déterminée par les dépenses du Royaume, ou pour le dire de manière plus contemporaine, l'offre est déterminée par la demande royale (il anticipe les théories de la demande effective de Keynes).
-
Il appartient enfin à la Couronne de soutenir l'activité économique en évitant la stérilisation de la monnaie par la thésaurisation ou par la fuite du pouvoir d'achat vers l'étranger. Ainsi la ruine de Carthage proviendrait de l'utilisation abusive de mercenaires, dont l'essentiel de l'argent rapatrier dans leurs pays d'origine, contribuant à vider les caisses de l'Etat, sans que cela n'accroisse la demande, partie vers l'étranger. Khaldoun fait sienne la théorie de Tite-Live sur la chute de Carthage.
Conclusion : l'Etat ne doit jamais thésauriser soi-même et doit combattre également la thésaurisation privée par une politique fiscale taxant l'épargne stérilisée pour réinjecter l'argent dans le circuit économique de production. Ainsi, sa politique fiscale pourrait se résumer de la manière suivante. Augmentation des impôts quand les riches épargnent, diminution quand ils investissent.
En outre, pour faciliter l'activité économique et maintenir la grandeur de l'Empire, l'Etat peut également soutenir l'activité économique par des dépenses sociales : l'aide aux nécessiteux, aux veuves, la construction d'hôpitaux, la formation de médecins, etc. cette politique de soutien de la dépense (on dirait aujourd'hui de relance) ne ruine en rien l'Etat, car en contre-partie, elle permet d'assurer la prospérité générale en réduisant les injustices.
Si ces idées résonnent encore en nous, c'est tout simplement parce qu'elles sont toujours et plus que jamais d'actualité! En effet, les idées de soutien à l'activité économique, de politique de relance, et de multiplicateur de la croissance défendues par Keynes dans sa Théorie générale (1946) ne sont rien de moins que certaines propositions déjà avancées par Ibn Khaldoun il y a plus de 700 ans maintenant !
Après lui, le déluge! Écrivant dans un siècle et une civilisation qu'il savait en déclin, il est le dernier grand représentant de la puissance de la civilisation arabe. À partir du XI, le basculement avait commencé à opérer avec un retour de l'Occident dans le concert des Empires. Du XI au XIII siècle, l'Europe va connaître une essor démographique important (sa population passant de 40 à 70 millions entre l'an mil et 1300), accompagné d'une prospérité économique importante. Dans le même temps, après plus de cinq siècles d'obscurantisme, les écrits des philosophes grecs vont être redécouverts. Aristote va devenir le maître à penser du haut-Moyen Age traduit, interprété et idolâtré par la scolastique.
Mais cela est une autre histoire, que je me plairai à vous conter une autre fois...
1. Ibn Khaldoun, Le Livre des exemples, Tome I, Paris, la Pléiade, 2002.
 1 commentaire
1 commentaire
-
-
Je me permets ici de faire un bond de quelques siècles, de manière tout à fait arbitraire, en laissant de côté l'héritage romain au point de vue de l'analyse économique. Si l'économie fut prospère sous la Grandeur de Rome (d'environ 150 avant J-C à 395 ap. J-C, date de la scission entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient gouverné par Byzance), les romains apportèrent peu dans le domaine des connaissances économiques. Leur approche était essentiellement empirique et pragmatique, sans effort analytique particulier, sauf exception.
Je vais donc présenter aujourd'hui, dans les (très) grandes lignes, ce qu'a été la pensée économique entre le VII et le XIV siècle, en me détournant volontairement de l'histoire exclusivement occidentale, relativement pauvre durant ces siècles d'obscurantisme sur le plan de l'analyse, pour ouvrir à l'histoire de la pensée économique arabe, alors civilisation prospère.
A partir du VII siècle, la civilisation arabe connaît un essor sans précédent, sur le plan culturel, scientifique, économique, géographique et religieux (avec la naissance du prophète Mahomet – Mohammed – en 570 et l'avènement de la religion musulmane dès l'Hégire, en 622). Les historiens font dater l'âge d'or de la civilisation arabe à partir de 750 environ sous la califat de Al-Mansour pour s'étendre jusqu'à la seconde moitié du XIII (1258). au XIV, sur lequel nous reviendrons prochainement, la civilisation arabe est déjà dans sa phase de décomposition.

Durant cette période qui s'étend sur plus d'un demi-millénaire, la civilisation arabe va bénéficier d'un rayonnement important dans le monde et va œuvrer à la sauvegarde et la réinterprétation des textes des anciens grecs, qui feront leur retour en Occident à partir du XV siècle seulement, grâce à leur diffusion par les arabes.
De nombreux intellectuels ont laissé leur marque, mais deux grands penseurs arabes ont davantage marqué cette époque et dont l'héritage a contribué au rayonnement de l'Occident par la suite. Ce sont Ibn Sida (950-1037) plus connu chez nous sous le nom d'Avicenne (ci-dessous), dont le Traité de Médecine est resté pendant de très nombreux siècles une référence essentielle ; et Ibn Rushd (1126-1198) plus connu sous le nom d'Averroès (représenté ci-contre), surtout connu en Occident pour avoir commenté et analysé l'œuvre d' Aristote. Nous pouvons les considérer avant l'heure comme des Encyclopédistes, leurs savoirs s'étendant à tous les domaines de la connaissance, philosophie, astronomie, mathématique, médecine, droit, théologie. Ils symbolisent à eux deux la puissance et le rayonnement intellectuels de la civilisation arabe de cette période.
Qu'en est-il alors plus précisément de la pensée économique sous la civilisation arabe?
A vraie dire, l'économie est comme en occident, une branche de la philosophie, de la morale ou de la théologie, mais elle n'occupe pas une position autonome, avec ses propres méthodes de conceptualisation. L'économie (qui n'est pas encore une science, il faudra vraiment attendre le XVIII pour cela) est davantage une pratique empirique au service de la loi morale et/ou de la loi divine. L'interprétation économique s'inscrit dans une interprétation du message de Dieu. A ce titre, et pour cette partie, je me réfère essentiellement à l'ouvrage de René Passet1.
Comme toute interprétation du message divin, il existe de nombreuses variantes et donc de nombreuses manières de concevoir l'activité économique. Ainsi, L'auteur distingue trois grandes interprétations économique du message divin. Nous ne les citerons pas toutes les trois, mais n'en prendront qu'une. Le but ici est juste de souligner combien la pensée économique reste encore balbutiante, inscrite, enracinée dans une pensée qui l'englobe et la subordonne.

Ainsi, les recommandations économiques qui suivent restent dans le cadre de préceptes, de modèles d'observance, mais n'entrent absolument pas encore dans un cadre analytique global.
Par exemple, si la recherche du profit et l'augmentation de la richesse personnelle sont bien vues, c'est parce qu'elles sont rendues conformes aux préceptes coraniques justifiant le bonheur par le profit. En revanche, la thésaurisation y est considérée comme négative. Mais pas en tant que limitative au développement et à la croissance économique (si l'épargne n'est pas réinvestie, alors l'argent n'a pas d'utilité, il devient improductif. Mais là on entre déjà dans l'analyse). Si la thésaurisation est décriée, c'est parce qu'elle nuit à l'individu, elle ne le sert point. Ainsi Muqafah écrit : « celui qui a de l'argent et un gain, mais ne sait pas les employer de manière parfaite, voit l'argent s'épuiser sans laisser de trace ; s'il le garde et dépense peu en vivant chichement, cela ne l'empêchera pas de le voir vite s'en aller d'entre ses mains2 ».
Ce sont davantage des recommandations pratiques, pour des raisons morales, plus qu'une analyse économique qui conditionne la pensée économique.
Un autre intellectuel3, au siècle suivant (IXème) va en revanche, tout en s'inspirant des principes coraniques, souligner l'avantage qu'il y a en plus de faire des profits, à conserver ses richesses. Son Livre des avares est un plaidoyer fourmillant de recettes pour ne pas épuiser ses richesses. Réduction du nombre d'enfants, sobriété alimentaire, sobriété vestimentaire (le prophète ne réparait-il pas lui-même ses sandales et vêtements?), investissement dans l'élevage et l'agriculture, aux rendements importants, etc.
Encore une fois c'est au nom de recommandations morales, assise sur une interprétation de la parole de Dieu que l'économie se pense. Nous sommes loin d'une vraie pensée analytique, mais encore au stade de conduites de vie.
En réalité, il faudra attendre le XIV siècle pour avoir une vraie réflexion économique en soi qui fasse système (la civilisation arabe a peu produit sur le plan économique, comme du reste la civilisation occidentale à la même époque). Ses titres de noblesse se situent plutôt du côté de la philosophie naturelle (ou sciences naturelles) que du côté de la philosophie morale (sciences humaines aujourd'hui).
C'est avec l'un des plus grands intellectuels de tous les temps (selon l'historien A. Toynbee) qu'une pensée économique originale va éclore, précurseur des travaux de Montesquieu et même de Keynes! Il s'agit du philosophe (au sens originel du terme, c'est-à-dire d'intellectuel des sciences en général) Ibn Khaldoun (1332-1406) qui va contribuer à concilier les exigences d'une méthode scientifique rigoureuse avec la soumission à la foi divine.
Mais nous étudierons plus avant sa pensée dans notre prochain billet, tant elle est riche et foisonnante.
1. René Passet, Les grandes représentations du monde et de léconomie à travers l'histoire, Paris, LLL, 2010.
2. Ibn al-Muqafah (Abdallah), Le Pouvoir et les Intellectuels, Paris, Maisonneuve et Larose, 1985, p. 39.
3. Jahiz, le Livre des avares, Paris, Maisonneuve et Larose, 1951.
 votre commentaire
votre commentaire
-
C'est à partir du VI siècle avant J.-C. que la pensée d'un monde ordonné, d'un tout cohérent régi par des lois et obéissant à une finalité commence à s'établir. L'impératif suprême pour l'homme consiste alors à se couler dans l'harmonie universelle1. Il faut donc partir de la Nature comme perfection, au sens de ce qui est Juste et Beau, pour établir le gouvernement des hommes. Le principe supérieur est le principe d'harmonie dans la pensée grecque.
Ce faisant, toute étude et pensée sérieuse doit être une pensée universelle, qui englobe l'ensemble des savoirs. À ce titre, la philosophie est considérée comme la science par excellence, car elle est la science du général. Toutes les activités de pensée particulières comme l'économie ne sont que des éléments inhérents à la pensée philosophique. Il n'existe donc pas à proprement parler d'analyse économique, ni de pensée économique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, seulement une application de la pensée universelle au domaine de l'économique.
En réalité, pour les grecs, le monde sensible, le microcosme social (la Cité-Etat) reste subordonné à l'harmonie universelle, considérée comme la valeur suprême. Pour autant, deux écoles de pensée vont se dégager autour de ce principe central. Une école spéculative, axée sur l'abstraction et le rationalisme théorique initiée par Socrate, poursuivie par Platon (427-347 av. J.-C.) ; une école sensualiste, basée sur l'observation, l'expérimentation et le raisonnement empirique, initiée avec Hippocrate, et prolongé par Aristote (384-322 av. J.-C.). Mais cette question ne nous intéressera pas directement ici.
Si la pensée grecque est une pensée de l'harmonie naturelle, ses incartades dans le champ de l'économie ont pour but de servir cette totalité. Ainsi, comme la nature est inégalitaire, les hommes le sont nécessairement également. De la même manière, cette inégalité naturelle conduit à distinguer des espèces, des fonctions spécifiques à la nature ; ainsi, il existe des catégories humaines différentes, aux fonctions spécifiques.
Cette superposition de la philosophie naturelle à la philosophie politique rend l'organisation sociale hiérarchique et inégalitaire. Ainsi, les hommes seront classés par rang (castes) selon leur facultés. Au sommet seront placés les hommes exerçant leur facultés de raison (fonction symbolique la plus importante dans une société ancrée sur l'intelligibilité et la perfection du monde), à la base ceux amenés à œuvrer dans des activités de transformation des formes et de la matière (activités les moins enviables dans une société gouvernée par la perfection et l'immuabilité du Tout).
En outre, dans ce système de pensée, les facultés ne sont pas acquises, mais innées et donc héréditaires, en raison du caractère naturel de ces dispositions. « En vertu de leur nature innée, certains hommes sont prédestinés à la soumission, d'autres au commandement2. » La conception grecque de l'ordre social est donc une conception aristocratique.
Qu'en-est-il de la pensée économique?
L'économie, au sens premier du terme concerne uniquement l'étude des règles de vie du quotidien (oïkos-nomia = règles de la maison). Elle ne signifie rien de plus que la satisfaction mesurée des besoins qui permet de sortir de l'état de nécessité pour accéder à la liberté.
Aristote la distingue de ce qu'il nomme la chrématistique (khrêma = richesse), qui correspond à l'échange monétaire dans les activités commerciales qu'il pourfend férocement lorsqu'elle conduit à faire de l'argent une richesse en soi, par le système du prêt à intérêt. L'argent, selon lui ne doit être qu'un facilitateur de l'échange, un intermédiaire d'échange entre deux marchandises (ce qu'il nomme la chrématistique nécessaire). Il ne doit pas être un moyen de produire plus d'argent (chrématistique pure) et donc de s'enrichir.
Si la monnaie est un instrument d 'échange, elle est également un instrument de mesure de la valeur, car elle permet de jouer un rôle d'étalon universel de la valeur d'une marchandise. Néanmoins, à ce titre, les deux auteurs divergent dans la manière de considérer ce qui fait la valeur de la monnaie elle-même.
Platon développe une approche nominaliste de la monnaie, selon laquelle sa valeur serait indépendante de la matière qui la constitue. C'est sa valeur affichée, écrite qui ferait sa valeur « réelle » ; de son côté, Aristote est hostile à cette conception. A son sens, pour que la monnaie conserve son statut d'équivalent universel de l'échange, il faut qu'elle possède une valeur propre liée à la matière qui entre dans sa composition. Pour lui, le métal précieux est le meilleur moyen en raison de sa mobilité, de son faible encombrement et de sa stabilité dans le temps. Il adopte ainsi une approche métalliste de la monnaie.
Dès les origines de la pensée économique, nous retrouvons les deux grandes conceptions de la monnaie qui traverseront les siècles : conception nominaliste avec Platon (qui donnera le système de Law, les billets, le système monétaire contemporain) conception métalliste avec Aristote qui dominera les échanges internationaux jusqu'à la fin de la première moitié du XX (avec le système de l'étalon-or).
Si les conceptions de la monnaie de Platon et d'Aristote divergent sur certains points, ils n'en restent pas moins d'accord sur le fond ; l'argent est secondaire, ce qui compte c'est la satisfaction des désirs. Voilà où est la véritable richesse.
Sur les questions de la propriété privée, là encore, les deux auteurs diffèrent. Quand Platon défend les vertus de la communalisation de la propriété, Aristote souligne les bienfaits de la propriété privée. Encore une fois, leur raisonnement n'a pas pour but d'analyser les conséquences économiques de la propriété privée, mais d'en mesurer ses conséquences sur le plan de l'harmonie de la vie de la Cité. La richesse doit rester stable de tout temps pour éviter de corrompre les âmes en aiguisant les appétits nous dit Platon. Ainsi, tout les biens et les terres appartiennent à la collectivité, afin de ne pas ennuyer l'esprit de considérations matérielles. Les gardiens et philosophes (au sommet de la hiérarchie) doivent avoir l'esprit libre et occuper aux seuls intérêts communs et à l'exercice d'un gouvernement harmonieux.
De son côté, Aristote, pour les mêmes raisons, insiste au contraire sur les vertus de la propriété privée au nom du caractère stimulant de l'intérêt individuel qu'elle permet. Encore une fois, non dans un but d'enrichissement personnel, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais toujours dans le but d'offrir au citoyen tout le temps de loisir nécessaire pour se consacrer à la vie de la cité.
Encore une fois, leur conception de la propriété n'entre pas dans une analyse économique ; elle n'a pas pour but de mesurer les effets positifs du point de vue du comportement économique des hommes, mais elle s'inscrit dans une théorie de l'ordre social où les gardiens de la cité doivent veiller au mieux à la vie et au gouvernement des hommes.
Enfin, on retrouve également chez ces deux auteurs les premières réflexions sur la division du travail. La division du travail s'impose d'elle-même pour deux raisons selon Platon : d'une part, elle est liée à l'insuffisance de l'homme, à son impuissance essentielle. Seul, il est incapable de se suffire à lui-même, et de subvenir aux différents besoins qu'il éprouve.
D'autre part, elle est liée à des raisons d'efficacité et de différenciation naturelle. « La nature n'a pas fait chacun de nous semblable à chacun, mais différent d'aptitudes et propre à telle ou telle fonction [...] Par conséquent, on produit toutes choses en plus grand nombre, mieux et plus facilement, lorsque chacun, selon ses aptitudes et dans le temps convenable, se livre à un seul travail étant dispensé de touts les autres3. »
C'est à peu de choses près ce que dira A. Smith près de deux mille ans plus tard. Il y associera le concept de productivité et de croissance économique, notion inconnue des grecs, pour qui la division du travail n'était que le simple reflet de la division des fonctions naturelles et de l'inégalité des forces dans la nature.
Pour résumer la place de la question économique chez les grecs, il nous suffit de comprendre que les activités économiques (comme toute autre activité d'ailleurs) sont soumises et subordonnées à l'organisation de la Cité, considérée comme le reflet sur le plan matériel et microcosmique de la perfection du macrocosme.
D'un côté, la pensée économique est encastrée dans la pensée philosophique qui s'accorde à trouver sur le terrain économique les applications de l'organisation de la nature ; d'un autre côté, l'analyse économique est encastrée dans la philosophie générale de l'organisation sociale et politique idéale, à l'image du macrocosme. On peut donc en conclure avec Schumpeter que « l'analyse économique rudimentaire est un élément mineur de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres culturels, les anciens grecs4 ».
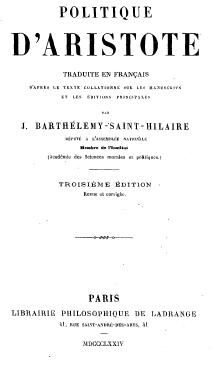
1. René Passet, Les grandes représentations du monde et de l'économie à travers l'histoire, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2010.
2. Aristote, La Politique, Livre II, Les Belles lettres, Paris, 2003.
3. Platon, La République, Paris, Garnier, 1959, p. 55.
4. Schumpeter, op. cit., p. 88.
 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
La lutte des classes existe, et c'est la mienne qui est en train de la remporter. W. Buffet



